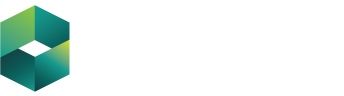La Cour suprême réaffirme la barre basse pour l’autorisation de recours collectifs au QuébecLe 30 octobre 2020, une majorité de six juges de la Cour suprême du Canada a confirmé, dans Le juge québécois qui s’est le premier à se prononcer sur la question a refusé de certifier (ou d'« autoriser » en vertu du droit québécois) la demande à titre de recours collectif, principalement parce que le demandeur n’avait pas démontré une « apparence de droit » (une exigence d’autorisation). Le juge a fait état de préoccupations liées à des allégations chauves ou spéculatives, à l’absence de documents à l’appui et à la question de savoir si les réclamations peuvent faire l’affaire dans le cadre d’un recours collectif. Mais la Cour d’appel du Québec et, maintenant, la Cour suprême du Canada ont renvoyé l’affaire en tant que recours collectif. Les deux paliers de tribunaux ont réaffirmé l’approche « souple », « libérale » et « généreuse » de l’autorisation énoncée dans des décisions antérieures de la Cour suprême du Canada appliquant le droit québécois des recours collectifs, y compris La décision de la majorité laisse entendre que, tant que les revendications ne sont pas frivoles ou clairement erronées en droit, alors les allégations ou les théories juridiques spéculatives, non étayées ou incomplètes pourraient ne pas être disqualifiantes en vertu du critère d’autorisation du Québec. Ce résultat suit les décisions antérieures, mais il met le Québec encore plus en décalage avec l’approche dominante en matière de certification ailleurs au Canada (surtout après que les récentes modifications apportées à la loi sur les recours collectifs de l’Ontario ont introduit un test de certification plus strict - voir notre article sur ces changements: Contexte et historique de la procédureRonald Asselin a investi dans des produits de dépôt à terme protégés par le capital, appelés « Perspectives Plus Term Savings » et « Alternative Term Savings », tous deux non encaissés jusqu’à l’échéance, offerts par la coopérative de services financiers Caisse Desjardins. Après la crise financière de 2008, la Caisse Desjardins a informé M. Asselin que son mandant, bien que toujours protégé, ne produirait aucun rendement et demeurerait non encaissé jusqu’à l’échéance. M. Asselin a demandé l’autorisation d’intenter un recours collectif contre plusieurs entités de la Caisse Desjardins, en se fondant sur deux théories de responsabilité civile alléguée :
Le juge saisi de la requête La Cour d’appel du Québec La Cour suprême autorise le recours collectifDans l’arrêt Asselin, la majorité de six juges de la Cour suprême était presque entièrement d’accord avec la Cour d’appel du Québec. La Cour suprême a conclu ce qui suit :
Trois juges dissidents de la Cour suprême, quant à eux, n’auraient autorisé qu’une partie de la demande, ce qui aurait considérablement réduit le recours collectif. Ces juges ont convenu qu’Infineon régit, mais l’ont interprété comme étant compatible avec une « procédure rigoureuse » à l’étape de l’autorisation. Faisant écho à l’approche adoptée dans les provinces de common law, les dissidents ont averti que l’autorisation devrait être « plus qu’une simple formalité » et que le tribunal ne peut pas « assumer le rôle de partie ou d’avocat et changer l’objet de l’action telle que présentée par le demandeur ». En vertu de cette conception plus solide du rôle du juge d’autorisation en tant que gardien, la dissidence a déclaré que la cour devrait s’assurer que les allégations sont « claires et complètes, non vagues, générales ou imprécises » - « [d]efects de forme peuvent être excusés, mais les défauts de fond ne peuvent pas l’être ». Asselin réaffirme la barre basse du Québec pour autoriser les recours collectifs, et pourrait sans doute l’abaisser davantage, surtout si les futurs tribunaux appliquent strictement l’idée que les juges d’autorisation devraient « filtrer les réclamations frivoles, et rien de plus ». Le prochain champ de bataille dans les recours collectifs au Québec pourrait être de savoir comment tracer la ligne entre les défauts de forme et de fond, et jusqu’où les juges d’autorisation peuvent aller pour « lire entre les lignes ». En Ontario, en revanche, la Cour d’appel a souligné l’importance d’examiner les actes de procédure à l’étape de la certification, reconnaissant dans Das v George Weston Limited, 2018 ONCA 1053, par exemple, que le juge de certification ne devrait pas présumer être vrai « des énoncés de fait conclusoires simples et des allégations de conclusions juridiques non étayé par des faits importants ». Ainsi, pour l’instant, le Québec demeure quelque peu aberrant dans les recours collectifs canadiens : les juges d’autorisation au Québec doivent chercher à éliminer les cas frivoles, mais sont autrement chargés d’évaluer les réclamations avec un œil relativement généreux s’ils peuvent identifier des causes d’action juridiquement reconnaissables. Auteur(e)s
Traduction alimentée par l’IA. Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques. Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com. |

S’abonner
Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.
Blogue